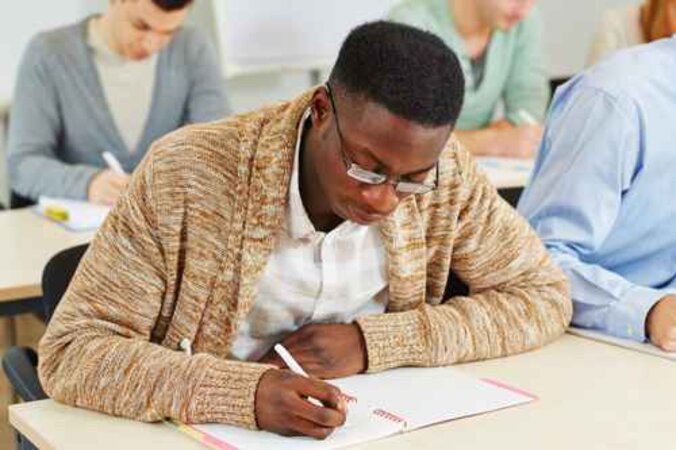24
jui 2016
#3 Migration et mobilité
Quand les langues africaines changent de lieux : dynamiques de standardisation des langues africaines à travers la diaspora
Société suisse d'études africaines (SSEA)
Comment les langues africaines passent-elles de l'oral à l'écrit, voire au numérique, dans le contexte de la migration ? Quel rôle jouent les structures administratives, les systèmes éducatifs et l'environnement socioculturel dans les sociétés dites d'accueil ?
La migration africaine s’est considérablement accentuée en Suisse au cours de la dernière décennie. Cette réalité se reflète dans la présence accrue de documents rédigés dans les langues fréquemment utilisées. Celles-ci ne correspondent pas nécessairement à la taille des langues sur le continent. Le somali et plus récemment le tigrinya sont des exemples frappants, utilisés régulièrement dans les brochures d’information et de prévention distribuées par des médiateurs, structures pédagogiques, sociales ou médicales. Cet effort de médiation façonne la langue en poussant à la standardisation des usages aussi bien qu’à la création de terminologies pour couvrir de nouveaux concepts. Le processus semble faire des communautés de la diaspora africaine des moteurs principaux de la modernisation des langues du continent. Il s’effectue en parallèle à l’effort de traduction d’interfaces de logiciels dans les langues africaines – un domaine encore largement dominé par des locuteurs expatriés de ces langues. Quelles dynamiques sous-tendent ces phénomènes de passage de l’oralité à l’écriture et même au numérique dans le contexte actuel de migration ? Quel rôle jouent les structures administratives, éducatives et socioculturelles des sociétés d’accueil dans ce sens ? Comment les langues africaines non utilisées dans les communications formelles se maintiennent ou se transmettent-elles d’une génération à l’autre ?
Programme/Agenda
Intervenant·e·s
Ismaël Diadié Haïdara, Fondo Kati (Tombouctou),
Archivar spezialisiert auf die Handschriften des Sahels und die historischen Wechselbeziehungen zwischen dem Spanischen, Arabischen, Hebräischen und afrikanischen Sprachen wie Songhai, Peul und Tamachek.
Martin Benjamin, LSIR/EPFL (Lausanne)
Der Anthropologe und Swahili-Experte hat die Online Wörterbuch-Plattform Kamusi an der EPFL entwickelt, die afrikanische Sprachen lexikographisch verknüpft. Benjamin ist in zahlreichen nationalen und internationalen digitalen Projekten aktiv, die sich mit afrikanischen Sprachen befassen (Projet Kamusi, Réseau Maaya, ACSIS-SCASI-Société Civile Africaine pour la Société de l’Information).
Mohamed Amara, Centre Max Weber (Lyon)
Der Soziologe befasst sich mit Sprachbildern und Mediengebrauch (Automedialisierung und soziale Aushandlungsprozesse im Kontext kultureller Übergänge).
Natalie Tarr (Basel)
Die Doktorandin im Fachbereich Afrikastudien befasst sich mit der Mehrsprachigkeit und Sprachgebrauch in Afrika, insbesondere mit der Beziehung zwischen Muttersprachen und internationalen Sprachen.
Djouroukoro Diallo
Der Doktorand mit breiter Unterrichtserfahrung (Bambara) befasst sich mit den Sprachpraktiken.
Frédéric Barbe (Nantes)
Der Geograph konzentriert sich auf Raum, Schrift und die Konstruktion der « bibliothèque mondiale », insbesondere der Dynamik von Buch und Presse in Afrika.